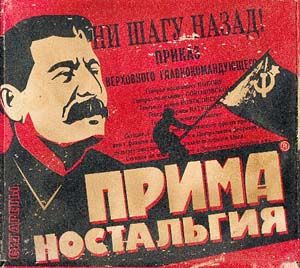La signature du traité de Guiorguievsk en 1783 marque l'entrée
de l'empire russe dans l'histoire de la Géorgie. Le royaume devient
un protectorat russe, ce qui n'empêchera pas la Russie de laisser les
armées géorgiennes seules face à l'offensive de shah
agha Mohamed khan en 1795. En 1801, comme le craignaient les plus farouches
adversaires du traité, la Russie annexe la Géorgie orientale
(l'histoire se répète...). La dynastie des bagratides est décapitée,
la royauté abolie et les prétendants au trône déportés.
De plus, l'église, jusqu'alors autonome, est placée sous l'autorité
du synode russe. Cependant, à la suite de l'annexion de la Géorgie
occidentale en 1860, un mouvement de résistance va naître et
s'étendre.
Le réveil
A l'aube du XXe siècle, la Géorgie connaît un réveil
national et culturel très intense dont l'intelligentsia géorgienne
est le fer de lance. Les préoccupations au centre des débats
concernent en premier lieu les questions de l'indépendance et de la
souveraineté nationales. des journaux (Iveria, Tsiskari, Sakartvelos
Moambé) sont publiés à l'initiative d'hommes de lettres
comme Ilya
Tchavtchavadzé. La lutte contre la russification se fait également
par le biais du théâtre, malgré la censure. En 1890, le
russe est proclamé langue officielle, le géorgien acquérant
le statut de langue étrangère. En 1905, l'église géorgienne
remet en cause le principe de sa soumission. La réaction russe est
brutale et sans appel : le clergé géorgien est déporté.
La révolution d'Octobre débouche sur la proclamation, le 9
avril 1918, de l'éphémère république de Transcaucasie
(qui inclut l'Arménie et l'Azerbaïdjan). Le 26 mai de cette même
année, la Géorgie proclame son indépendance et Noé
Jordania est élu au suffrage universel. La constitution de cet état
révèle une grande modernité : droit de vote des femmes,
abolition de la peine de mort, séparation de l'église et de
l'état ! En 1920, la Russie reconnaît la république de
Géorgie et signe un traité de paix avec elle. Mais la menace
bolchévique se fait de plus en plus précise.
Les années soviétiques
La jeune Armée Rouge lance l'attaque le 12 février 1921, et
Tbilissi tombe le 25. Le gouvernement de Jordania prend le chemin de l'exil
vers la France (ce sera la seule vague d'émigration géorgienne),
et le pays est rebaptisé république socialiste de Géorgie.
Toute velléité d'indépendance de sa part est durement
réprimée, mais cela n'empêchera pas les géorgiens
de faire preuve d'insoumission à maintes reprises de 1921 à
1991.
En 1922, 30 % de l'intelligentsia est supprimée
; en 1924, 7000 personnes sont fusillées en place publique ; en 1956,
des manifestations pour l'indépendance sont sévèrement
réprimées ; en 1962, 450 étudiants sont fusillés
devant le palais du gouvernement ; en 1973, de virulentes manifestations ont
lieu en opposition à l'apprentissage obligatoire de la langue russe
dans les écoles. La nomination de Béria au poste de chef du
PC de Transcaucasie en 1932 et les purges des années 37-38 vont asseoir
l'ordre soviétique en Géorgie au prix de milliers de victimes.
Avec la mort de Staline
(5 mars 1953) et la publication du rapport Khroutchev (1956), le dégel,
tout relatif qu'il soit, donne l'occasion aux géorgiens de manifester
pour l'autodétermination ; l'agitation estudiantine sera cependant
rapidement étouffée. Les années 70 sont marquées
par le réveil des mouvements d'opposition au régime communiste
(incendie de l'Opéra, plasticage du monument au traité de Guiorguievsk).
En avril 1978 se déroule aussi à Tbilissi une manifestation
pour la défense de la langue géorgienne, dont la nouvelle constitution
de l'URSS stipule qu'elle n'est qu'une langue étrangère.
L'arrivée au pouvoir, en 1985, de Mikhaïl
Gorbatchev, et la mise en oeuvre de la perestroïka et de la glasnost
vont sonner le glas de l'empire soviétique. Les républiques
allogènes vont réagir plus ou moins violemment à ce processus
d'éclatement : le Caucase, qui reste, au même titre que les balkans,
une poudrière, sera embrasé par plusieurs conflits meurtriers
dont les conséquences pèsent encore très lourd aujourd'hui.
Une douloureuse indépendance
En Géorgie, les revendications populaires se multiplient,
dans un climat d'agitation et de fièvre. Le 9 avril 1989, une manifestation
pacifique réunissant femmes, enfants et vieillards est brutalement
réprimée par le ministère russe de l'intérieur
et fait, selon le bilan officiel, 16 morts. La loi martiale est décrétée
et les tensions s'exacerbent dans un pays en état de choc. Parallèlement,
deux régions de Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
proclament leur souveraineté, non reconnue par le gouvernement géorgien.
Le 28 octobre 1990, la coalition indépendantiste
"Table ronde" remporte les élections législatives.
Le statut d'autonomie de l'Ossétie est presqu'aussitôt annulé
par le parlement, et l'année 1991 débute par de violents affrontements
à Tsinkhvali, capitale de l'Ossétie du Sud. Le 9 avril 1991,
la Géorgie proclame son indépendance, et en mai 1991, Zviad
Gamsakhourdia est élu président avec 75 % des voix. Cependant,
ses méthodes autoritaires et ses orientations ultranationalistes entraînent
rapidement le mécontentement d'une partie de la population et la formation
d'une opposition. Le conflit entre les deux partis s'envenime et débouche
sur la dissolution du parlement en septembre 1991. Puis, en janvier 1992,
c'est la guerre civile. Des combats de rue éclatent dans le centre
de Tbilissi et finissent par forcer Gamsakhourdia à s'enfuir en Arménie
(puis plus tard en Tchétchénie auprès du général
Doudaïev).
Les forces d'opposition victorieuses constituent un conseil
militaire qui assure la continuité du pouvoir jusqu'au retour d'Edouard
Chevarnadzé, sollicité pour assurer la succession. Ce dernier
est élu président du parlement en octobre 1992, puis président
de la république en novembre 1995. Les tensions sont toujours extrêmement
vives entre partisans de l'ancien et du nouveau président. De
plus, le conflit à propos de l'autonomie abkhaze, latent depuis 1989,
va s'exacerber et donner lieu à de multiples affrontements à
partir de la déclaration unilatérale d'indépendance de
cette province en juillet 1992. Edouard Chavernadzé accuse la Russie
d'ingérence ; la guerre fait rage sur le territoire abkhaze d'où
les habitants géorgiens ont été chassés (plus
de 250 000 réfugiés). L'Abkhazie sort évidemment victorieuse
du conflit et les forces Géorgiennes sont forcées d'abandonner
ce territoire bordant la mer Noire.
Le 14 mai 1994, un cessez-le-feu entre géorgiens
et abkhaziens intervient ainsi sous la médiation russe. Toutefois,
la question abkhaze est actuellement loin d'être réglée,
même si le conflit armé a pris fin. Le problème du retour
des réfugiés géorgiens en Abkhazie est toujours en suspens,
et les négociations de paix sont au point mort. La société
géogienne a aussi d'autres difficultés.