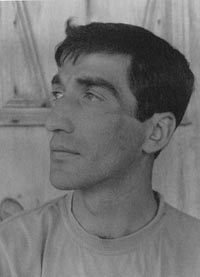Les gens
La population géorgienne apparaît au visiteur comme se comportant
de façon fort variable. Il peut en effet aussi bien recevoir des coups
de pied au derrière lorsqu'on estime qu'il bouche le passage, ou se faire
agoniser d'insultes par un ivrogne dans la rue, que se faire recevoir avec un
raffinement et une courtoisie qu'un prince ne renierait pas. A quoi donc ressemblent
les habitants du pays des kartvels ?
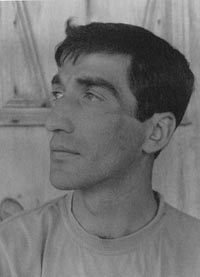 |
Ci-contre un bon exemple du type géorgien masculin. Les caractéristiques
physiques uniformément répandues dans la population sont
: nez et oreilles proéminents, lèvres minces, menton volontaire,
pilosité fournie, carrure puissante, teint jaune ou parfois verdâtre.
Signalons aussi une tendance à l'empâtement qu'il est difficile
d'attribuer spécifiquement à l'inné ou l'acquis.
Les hommes sont à l'image de leur apparence : francs, directs,
sensuels. Il est rare de les voir sourire, mais pas de les entendre rire
à gorge déployée. Il y a un côté bourru
dans l'affection qu'ils prodiguent à leurs proches : deux hommes
amis se font une bise retentissante en se rencontrant, et se promènent
bras dessus-bras dessous.
Les passe-temps favoris sont : boire, fumer, causer politique ou jouer
au nardi (backgammon). Ce qui rendrait la gent masculine plutôt
sympathique si elle ne faisait preuve d'une autorité absolutiste
sur les femmes, qui paraît excessive à une mentalité
minimalement progressiste.
|
 |
Les femmes géorgiennes, quand on les croise
dans les rues, font preuve de discrétion et retenue. Elles sont
en effet conditionnées dès l'enfance à ne pas faire
de vagues : on passe beaucoup moins de choses aux jeunes filles qu'aux
jeunes garçons. On les prépare le plus possible au mariage,
institution obligée (l'union libre est inconcevable, et se tenir
la main sans qu'une alliance y brille est générateur de
scandale), où elles auront la haute main sur les corvées
domestiques ou l'éducation des enfants.
Il est d'ailleurs de bon ton, pour un jeune géorgien, d'enlever
la femme dont il veut faire sa compagne, sans qu'elle ait évidemment
voix au chapitre. Un professeur de français de Kutaïssi, qui
avait été victime de pareil agissement, osa remettre en
cause le principe de soumission et quitter son mari : elle est depuis
stigmatisée dans toute la ville comme une fille publique.
|
Heureusement, les femmes géorgiennes commencent à revendiquer
autrement qu'individuellement une place différente dans la société.
Jusqu'ici, leur activité était strictement limitée aux
domaines de l'enseignement (très fortement féminisé) ou
de la santé publique (mèdecins ou infirmières). Certaines
se lancent dans les affaires et font d'excellentes "business women".
Ce phénomène reste hélas circonscrit à la capitale,
les mentalités évoluant par définition plus lentement en
province.
Les relations parents-enfants sont dominées par un amour possessif pouvant
aller jusqu'à l'étouffement et par un dévouement à
toute épreuve. Les problèmes de logement posent de grandes difficultés
: il n'est, en effet, pas rare de voir trois générations cohabiter
sous un même toit. Le système présente certains avantages
(mise en commun des ressources alimentaires, garde des enfants par les grands-parents),
mais la promiscuité peut s'avérer parfois pesante, surtout pour
les jeunes.
Ceux-ci se tournent volontiers vers un modèle plutôt américanisé
et consommateur. Ils assimilent avec enthousiasme les nouvelles tendances musicales
ou vestimentaires. A défaut de trouver une activité qui fasse
sens dans la société géorgienne d'aujourd'hui, mieux vaut
briller de tous ses feux. D'où le côté un peu ostentatoire
des relations sociales entre jeunes : posséder un portable ou un beau
couteau confère un certain empire sur ses contemporains.
Il y a aussi la télévision, dont les nombreuses chaînes
diffusent à longueur de journée des émissions d'un niveau
intellectuel contestable (les programmes les plus suivis sont la version géorgienne
de "Qui veut gagner des millions" ou le tirage du loto). Ici comme
ailleurs, donner de faux espoirs engendre du profit. La publicité a fait,
elle aussi, une entrée remarquée, dans sa version nationale (portables
"Geocell" ou vodka "Rustavi") comme internationale (soda
"Coca-cola" ou cigarettes "Gauloises"), et nombreux sont
les panneaux qui fleurissent au bord des routes.